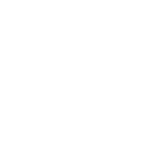La baronne Léonie de Waha
Issue de deux grandes familles de la noblesse libérale, Léonie Marie Laurence de Chestret de Haneffe est née le 03 mars 1836 à Tilff, dans la province de Liège. Son père était le baron et futur sénateur Hyacinthe de Chestret de Haneffe et sa mère la noble Amanda Laurence de Sélys Longchamps.
Sa mère étant décédée alors qu’elle avait deux ans, Léonie a grandi au château de Colonster et a été éduquée par son père et des tuteurs privés. Elle devint une femme libérale, démocratique, tolérante et croyante, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire et apprit à parler plusieurs langues. En 1863, à l'âge de 27 ans, elle épousa le baron et juriste Louis Auguste de Waha-Baillonville, avec lequel elle eut une fille après trois ans de mariage, qui décéda cependant en bas âg. Un an plus tard, Léonie de Waha subit un nouveau coup du sort lorsque son mari mourut à son tour.
Après la mort de son mari, elle décida de s'engager davantage, de se consacrer à l'émancipation et par là poursuivre le travail d'intérêt général de son mari. Elle est décédée le 8 juillet 1926 à son domicile de Tilff à l'âge de 90 ans et a été nommée officier du Mérite wallon à titre posthume en 2012.
Sa mère étant décédée alors qu’elle avait deux ans, Léonie a grandi au château de Colonster et a été éduquée par son père et des tuteurs privés. Elle devint une femme libérale, démocratique, tolérante et croyante, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire et apprit à parler plusieurs langues. En 1863, à l'âge de 27 ans, elle épousa le baron et juriste Louis Auguste de Waha-Baillonville, avec lequel elle eut une fille après trois ans de mariage, qui décéda cependant en bas âg. Un an plus tard, Léonie de Waha subit un nouveau coup du sort lorsque son mari mourut à son tour.
Après la mort de son mari, elle décida de s'engager davantage, de se consacrer à l'émancipation et par là poursuivre le travail d'intérêt général de son mari. Elle est décédée le 8 juillet 1926 à son domicile de Tilff à l'âge de 90 ans et a été nommée officier du Mérite wallon à titre posthume en 2012.
Travail d'intérêt général
Après avoir perdu son mari dans sa jeunesse, elle a décidé d'investir davantage dans l'éducation des jeunes filles et des femmes, qui n'étaient généralement soutenues que par des institutions catholiques. Mais elle voulait aussi offrir des lieux d'accueil en dehors de ceux-ci, afin de permettre à une population plus large d'y accéder.
Elle poursuivit le travail de son mari en faisant construire des bibliothèques à Chênée et Esneux et en soutenant de nombreuses organisations caritatives.
Afin de promouvoir davantage la situation sociale dans la région, de Waha a créé une école de couture à Tilff et a contribué au développement de jardins d'enfants et d'écoles dans l'arrondissement de Saint-Gilles. Avec le parlementaire libéral, Julien d'Andrimont, elle a soutenu la création de maisons ouvrières fonctionnant selon le système mulhousien. Cela ouvrait aux locataires la possibilité de devenir propriétaires de leur logement au bout de seize ans, ce qui permettait d'améliorer leurs conditions de vie.
Elle poursuivit le travail de son mari en faisant construire des bibliothèques à Chênée et Esneux et en soutenant de nombreuses organisations caritatives.
Afin de promouvoir davantage la situation sociale dans la région, de Waha a créé une école de couture à Tilff et a contribué au développement de jardins d'enfants et d'écoles dans l'arrondissement de Saint-Gilles. Avec le parlementaire libéral, Julien d'Andrimont, elle a soutenu la création de maisons ouvrières fonctionnant selon le système mulhousien. Cela ouvrait aux locataires la possibilité de devenir propriétaires de leur logement au bout de seize ans, ce qui permettait d'améliorer leurs conditions de vie.
„Lycée de Waha“
Comme il n'existait jusqu'à la fin du XIXe siècle aucune possibilité pour les jeunes filles d'obtenir, en dehors des couvents et des écoles catholiques, un diplôme leur permettant d'accéder à l'université, le bourgmestre de Liège de l'époque s'est adressé à Léonie de Waha. Elle soutint l'idée de créer un lycée et acheta ainsi un bâtiment dans la rue Hazinelle pour y fonder en 1868 l'"Institut supérieur de demoiselles". L'école devait permettre aux jeunes femmes d'accéder à l'enseignement supérieur après une longue période d'attente.
L'enseignement religieux optionnel, en particulier, a été conçu de manière pluraliste, en ce sens qu'il pouvait être suivi auprès d'ecclésiastiques catholiques, protestants ou juifs. C'est précisément ce qui a suscité les critiques de l'évêque de Liège, qui a menacé d'excommunier tous ceux qui fréquentaient l'école. Seul l'évêque suivant révoqua ce jugement.
Plus tard, l'école a été subventionnée par la province, ce qui a rendu l'inscription à cette école gratuite, contribuant ainsi à l'amélioration du système éducatif local. L'école a alors pris le nom de Lycée de Waha.
L'enseignement religieux optionnel, en particulier, a été conçu de manière pluraliste, en ce sens qu'il pouvait être suivi auprès d'ecclésiastiques catholiques, protestants ou juifs. C'est précisément ce qui a suscité les critiques de l'évêque de Liège, qui a menacé d'excommunier tous ceux qui fréquentaient l'école. Seul l'évêque suivant révoqua ce jugement.
Plus tard, l'école a été subventionnée par la province, ce qui a rendu l'inscription à cette école gratuite, contribuant ainsi à l'amélioration du système éducatif local. L'école a alors pris le nom de Lycée de Waha.
cliquez autour pour fermer
„Union des femmes de Wallonie“
Outre son engagement en faveur de l'amélioration des chances d'éducation, Léonie de Waha s'est engagée dès la fin du 19e siècle pour l'amélioration des droits des femmes, notamment le droit de vote des femmes et un meilleur environnement de travail.
Ce faisant, elle visait entre autres à améliorer la confiance en soi des femmes, à renforcer la conscience de l'égalité des droits et à soutenir l'indépendance financière. Afin de promouvoir la conscience politique wallonne des femmes, Léonie de Waha a fondé l'Union des femmes de Wallonie, qui s'est penchée sur l'autonomie de la Wallonie et l'émancipation.
Toutes les femmes étaient invitées à adhérer à l'Union, qui se préoccupait de justice, de solidarité et d'amour de la patrie. Pour exprimer cela et renforcer la conscience politique, elles entreprirent diverses activités et publièrent une feuille journalistique.
Léonie de Waha rédigea également des articles pour différentes revues wallonnes telles que "La Barricade" et "La Femme wallonne" et dirigea encore l'Union jusqu'à son décès à l'âge de 90 ans en 1926.
Ce faisant, elle visait entre autres à améliorer la confiance en soi des femmes, à renforcer la conscience de l'égalité des droits et à soutenir l'indépendance financière. Afin de promouvoir la conscience politique wallonne des femmes, Léonie de Waha a fondé l'Union des femmes de Wallonie, qui s'est penchée sur l'autonomie de la Wallonie et l'émancipation.
Toutes les femmes étaient invitées à adhérer à l'Union, qui se préoccupait de justice, de solidarité et d'amour de la patrie. Pour exprimer cela et renforcer la conscience politique, elles entreprirent diverses activités et publièrent une feuille journalistique.
Léonie de Waha rédigea également des articles pour différentes revues wallonnes telles que "La Barricade" et "La Femme wallonne" et dirigea encore l'Union jusqu'à son décès à l'âge de 90 ans en 1926.
L'autonomie de la Wallonie
L'autonomie de la Wallonie a été une préoccupation de longue date et importante pour Léonie de Waha. En particulier lorsque le mouvement a pris de l'ampleur au début du 20e siècle, elle a correspondu avec les dirigeants Julien Delaite et Jules Destrée.
Dans son école secondaire, elle a également accordé une grande importance à l'histoire locale et a appris aux élèves à se sentir liés à leur région.
C'est elle qui a proposé d'utiliser les couleurs de Liège comme emblème de la Wallonie. C'est également elle qui a proposé d'utiliser la gaillarde, une fleur de cocarde rouge et jaune, comme emblème. Aujourd'hui encore, les couleurs et la fleur sont des signes de la Wallonie. L'une des plus hautes distinctions de la région est également une gaillarde d'argent.
Dans son école secondaire, elle a également accordé une grande importance à l'histoire locale et a appris aux élèves à se sentir liés à leur région.
C'est elle qui a proposé d'utiliser les couleurs de Liège comme emblème de la Wallonie. C'est également elle qui a proposé d'utiliser la gaillarde, une fleur de cocarde rouge et jaune, comme emblème. Aujourd'hui encore, les couleurs et la fleur sont des signes de la Wallonie. L'une des plus hautes distinctions de la région est également une gaillarde d'argent.